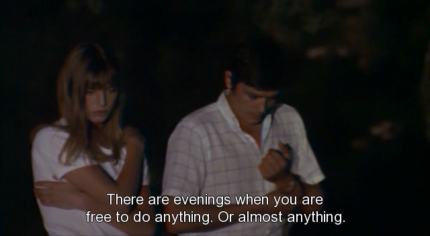Lavande et chant des criquets, lourd ciel bleu dont s’évader par un saut dans les flots… Tel est l’idyllique paysage où dorer des vacances au soleil de la Côte d’azur. Avec un couple d’amoureux qui étire ses étreintes aux quatre coins de la piscine, la vie se change aisément en un long fleuve tranquille. Il n’y a rien à faire, rien à penser. Juste des corps qui bronzent, des esprits qui sommeillent dans la citadelle de l’insouciance. C’est dans ce décor cousu d’indigo et de chair qu’en 1969, Jacques Deray a redonné ses lettres de noblesse à la Dolce Vita.
Seulement, Marianne et Jean-Paul ne se contentent pas de leur solitude. Les amants auxquels Romy Schneider et Alain Delon prêtent leur visage se piquent d’une compagnie imprévue. Comme pour pimenter la langueur des caresses, ou du moins titiller la jalousie de son beau ténébreux, la douce Marianne accueille à bras ouverts son vieil ami Harry Lannier, alias Maurice Ronet, lorsqu’il lui passe un coup de fil manifestant son intérêt pour la grande villa provençale. Et puisqu’un triangle amoureux n’est vraiment valable que s’il est carré, ledit Harry arrive en compagnie de sa fille, qui n’est pas n’importe quelle fille. Personne n’en avait entendu parler, mais elle a déjà dix-huit ans. Elle est incarnée par la frêle et sauvage Jane Birkin au pinacle de sa fraîcheur.
Il n’y a plus qu’à laisser les angles se rapprocher. L’antipathique Harry mène un double travail de fond, pour convoiter les charmes d’une Marianne qui en joue et s’attirer les foudres d’un Jean-Paul méfiant. La jalousie fonctionne, elle précipite l’histoire. Il n’y a qu’à ouvrir les yeux pour voir que Pénélope Lannier, fille de l’invité surprise, a tout pour séduire l’amoureux délaissé. Deux lignes se déplacent, l’intrigue progresse. Tandis que Marianne danse un slow avec Harry, dont elle a tout fait pour ne pas cacher qu’il aurait pu être son ancien amant, Jean-Paul se réfugie auprès de Pénélope, et enlace sa fine taille qui n’est plus vraiment celle d’une enfant. Les deux hommes jouent au combat de coqs et les femmes à tisser une complicité mère-fille. Mais au milieu de tous ces jeux, sous la candeur d’un azur égal, voilà que la scène fatale intervient.
Ce n’est pas celle du meurtre, qui n’en est qu’une conséquence. Lorsque Jean-Paul tuera Harry en le noyant dans la piscine, les dés auront déjà été jetés. L’invité sera allé trop loin, il l’aura attaqué sur ses deux privilèges rien qu’à lui, l’écriture et l’amour, il aura refusé que sa fille puisse être emportée comme joli lot de consolation. En réalité, c’est peu avant le crime nocturne que tout se précipite. C’est l’après-midi, lorsque Jean-Paul et Pénélope partent faire un tour. Ici, la caméra joue à piéger nos regards. Elle ne montre rien de leur escapade au bord de la mer, elle suggère. Elle laisse tout en secret, souligne juste les effets. Quand Jean-Paul et Pénélope rentrent de la plage, ils rient comme des amants ivres de plaisir et la jeune fille a les cheveux mouillés. Mais que s’est-il passé entre eux, alors que l’œil de la caméra restait braqué sur les flirts de Marianne et Harry au bord de la piscine, c’est toute la question.
La logique voudrait qu’ils se soient embrassés, qu’ils se soient aimés. Une ellipse ayant passé sous silence les quelques heures que Jean-Paul et Pénélope ont vécues seul à seule, on ne peut les juger qu’à l’aune des causes et conséquences. L’adolescente plaisait à l’homme fait, il a ensuite noyé son père qui l’empêchait de la conquérir, un ébat illicite a donc dû remplir la case manquante. C’est en tout cas ce que songent Marianne et Harry qui les voient rentrer guillerets à la villa, ce que songe aussi le spectateur. Un homme et une femme, c’est toujours la même chose. Un homme en plus qu’un autre rend jaloux, une femme qui découvre l’amour. Le scénariste a caché la scène, mais son contenu ne semble pas faire mystère.
D’un autre côté, on peut tout imaginer. C’est l’intérêt. Jean-Paul a une trentaine bien dépassée tandis que Pénélope arrive à l’âge de la majorité. Elle est présentée sous le rôle de l’enfant et lui sait-on jamais d’un père en devenir. Peut-être alors, se dira le spectateur en un second regard, qu’il ne s’est rien passé entre eux, mis à part la reconstitution d’une tendresse paternelle. Harry Lannier ne prenait pas grand soin de sa fille et sans doute a-t-elle eu besoin, au coin de l’épaule de Jean-Paul, de retrouver ces bénins égards qu’un homme adulte offre à la jeunesse. Ils ne se sont pas aimés dans ce cas, ils se sont juste compris.
Peut-être encore, ajouterait une troisième lecture, qu’il n’y avait pendant cet après-midi arraché à l’œil de la caméra même pas l’ébauche d’un lien sentimental. Ni celui d’une femme pour un homme, ni celui d’une fille pour un père de substitution. Après tout, ils se connaissent à peine. Le seul point qui les unit, c’est celui d’une égale défiance à l’égard des caresses qui naissent entre Marianne et Harry. Pénélope y perd son peu d’attention paternelle, et Jean-Paul son reste d’orgueil conjugal. Sans s’être embrassés, ni même s’être écoutés, peut-être se sont-ils simplement liés pour se venger. Tous les deux, seuls à la plage en laissant planer l’énigme, voilà la parfaite recette pour sanctionner le flirt des deux autres par une angoisse bien méritée. Dans ce cas le silence, se dit le spectateur, n’aura pas masqué les jeux de l’amour et du hasard ni ceux du père retrouvé, mais la commune entente d’une revanche.
Les hypothèses affluent donc de toutes parts. Et pourtant, il reste impossible de savoir ce qui est vraiment arrivé, pendant cette page de doute où deux personnages se rendent seuls à l’ombre de l’écran. C’est là qu’au milieu des lavandes et des flots, pour éclairer nos soupçons, la Critique de la raison pure intervient.
Ce que dirait Kant, s’il avait vu Jacques Deray, c’est que cette impossibilité de savoir ce qui s’est passé n’est pas conjoncturelle, elle est métaphysique. Ce n’est pas qu’il faudrait à la fois beaucoup de temps et d’informations pour saisir la réponse, mais seulement que de façon structurelle, il n’y a pas de réponse. C’est l’interprétation la plus scientifique et la moins satisfaisante, que nous livre la boîte à outils conceptuels de son œuvre maîtresse.
Avec le philosophe allemand, on a l’habitude de distinguer phénomènes et noumènes. Les premiers sont les choses qui se présentent à nos sens, qui s’y imposent même, celles que par commodité on pourrait nommer les apparences mais qui en fait constituent le tissu même du réel. Tout est phénomène, de ce lézard que je regarde en train de chauffer au soleil à mon corps naturel qui se plie au vent des choses. Le noumène quant à lui, c’est peut-être le vrai fond des êtres mais il ne représente rien de connaissable. Il y a par exemple cette chaise que je vois devant moi et cette même chaise telle qu’elle est pour elle-même ; l’une est soumise au regard, toujours biaisé et tronqué de l’homme, tandis que l’autre parfaitement indépendante ne cesse de s’y dérober. La première est la chaise-phénomène, seule réalité connaissable pour nous autres créatures éphémères, quand bien même cette connaissance en serait partielle ou partiale. La seconde est la chaise-noumène, la chaise-en-soi ; et elle, seul Dieu la connaît et la régit, seul l’être pur la conçoit.
Mais Dieu, dans le cas d’un film, il n’existe pas. C’est un homme. C’est le réalisateur. Si l’on applique la distinction entre les deux chaises à la scène qui nous intéresse, alors il y aurait d’une part ce que l’homme voit, ce que la caméra daigne montrer au spectateur, et puis d’autre part ce qui existe indépendamment des apparences, c’est-à-dire ce qui s’est vraiment passé sur la plage entre Pénélope et Jean-Paul. La bande filmique est le phénomène, avec ses points de vue choisis et partiels ; l’histoire est le noumène. L’une est une suite d’apparences alignées sous forme de plans-séquences, l’autre l’authentique vérité qui s’écoule à l’ombre.
Seulement bien sûr, ce n’est pas si simple. Le problème avec les histoires de cinéma, c’est qu’il s’agit de fictions. Les personnages n’étant rien d’autre que des personnages sans s’appuyer sur des personnes, l’espace de divergence entre ce qui est montré et ce qui est vécu est égal à zéro. C’est-à-dire qu’il ne s’est rien passé entre Pénélope et Jean-Paul au silence de la mer, dans la mesure même où il s’est tout passé. Chacune des hypothèses prise isolément est vraie et fausse également. La tradition binaire de la logique aristotélicienne en prend un sacré coup. Il n’y a plus de dichotomie entre ce qu’ils ont fait et ce qu’ils n’ont pas fait. Si deux spectateurs se bagarrent pour savoir qui a raison, entre celui qui soutient qu’ils se sont livrés à d’infinis ébats sur la plage et celui qui prétend qu’ils n’ont que doucement flâné en pestant contre les autres, l’arbitre du réel dirait qu’ils ont tous deux brillamment deviné. Car il n’y avait rien à deviner. Ce qui est montré par la caméra coïncide exactement avec ce qui s’est passé au revers de la caméra. Ce n’est rien.
Avec le film, pour tout dire, un drôle de jeu métaphysique se met en place. C’est peut-être l’un de seuls objets donnés à nos sens où le phénomène et le noumène sont strictement équivalents. Les autres types de fiction ne présentent pas pareille illusion. Dans le livre ou la peinture, une forte césure sépare l’univers ordinaire de l’objet spécifique que l’œuvre imprime à nos sens. La peinture est littéralement l’image, le livre littéralement le texte, et rien sinon la jouissance esthétique ne déborde la donnée phénoménale. Mais le cinéma brouille les cartes. Il fait semblant. Il nous fait croire que ce qu’il montre se trouve sur le même plan que la vie, puisque ce sont de vrais individus qu’il met en scène, de vrais paysages et de vrais sons, des événements qui se voient, un véritable écoulement temporel.
Ce que nous apprend La Piscine, c’est à faire une distinction. L’interprétation n’est pas la science. Si ce qui s’est passé entre Pénélope et Jean-Paul au bord de la mer n’est pas montré par la caméra, c’est juste que cela n’existe pas. La scène que le réalisateur a rejetée hors écran n’est pas une réalité cachée, mais un vide ontologique, un absurde néant au cœur de l’intrigue. On passe alors de la découverte à l’invention. Le spectateur, en interprétant l’invisible, ne comble pas les blancs d’un puzzle déjà formé, mais il dessine et bâtit de nouvelles pièces. Dès qu’il émet une hypothèse, celle d’un baiser furtif à la plage ou d’une platonique vengeance, il s’arrache à la sphère du savoir pour ajouter au film un acte qui n’en faisait structurellement pas partie. Assistant cinéaste plutôt que savant, il compose à lui seul les non-dits de l’histoire. Puisqu’aucun noumène n’existe derrière les phénomènes, il en pallie l’absence en inventant d’autres phénomènes.
Alors Birkin et Delon auront beau essayer, leur scène fantôme reste un trompe-l’œil qui ne dissimule rien. C’est qu’il n’y a sans doute jamais de hors-champ au cinéma mais juste du hors-cadre. Le hors-champ, c’est cette vieille idée que par-delà ce qui est mis à l’image, il y a tout un faisceau d’événements non montrés qui existent dans l’univers hypothétique du film. Mais peut-être faut-il se résigner à placer l’existence entre les seules bornes de l’écran. C’est sur ce fragile rectangle de projection que la narration naît et s’achève. Passé la frontière de l’espace optique, il n’y a qu’un désert tissé d’arrières-mondes hallucinés. Tout y est possible, car aucune présence n’y précède nos interprétations. Sous le soleil de la Côte d’azur, seul est vrai ce qui est visible. L’apparence seule est pourvue de réalité. Il n’y a pas de point aveugle, ce cher noumène vu par la Critique comme la muette toile du monde, autour duquel tournent nos efforts de déduction. Si on ignore un geste, un sourire ou un drame, c’est simplement qu’il n’est pas. Il n’est rien, et transforme l’inconnaissable kantien en néant. Avec La Piscine, fini les choses en soi.